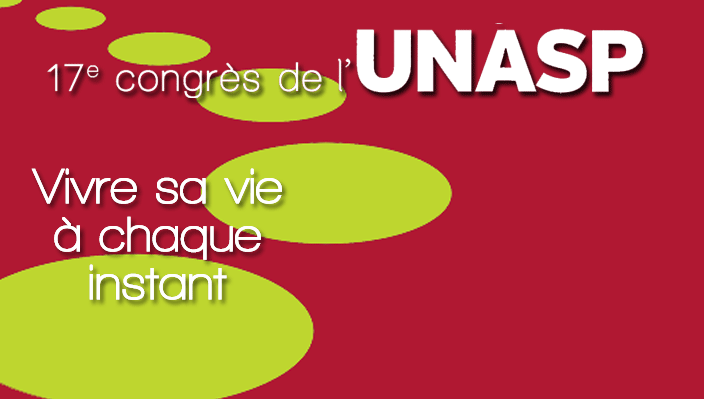Intervention de Bernard de Maisonneuve, psychanalyste et acteur en Soins Palliatifs
Le 26 septembre 2015 à La Rochelle.
C’est un honneur de m’adresser à cette assemblée de bénévoles, accompagnateurs de personnes en fin de vie et leurs familles et j’en remercie le président de l’ASP17. Pendant quinze ans, j’ai tenté d’être acteur de la mise en place de la philosophie des soins palliatifs auprès de différents lieux, hôpitaux, maisons de retraite, mais aussi dans le cadre de rencontres singulières, auprès de personnes en fin de vie, leurs familles, les équipes soignantes ou accompagnantes.
De chaque accompagnement, j’ai pu retenir que le drame vécu par la personne en fin de vie s’épanouissait en un rythme ternaire : 1 – le refus, 2 – le subir, 3 – l’acceptation ; ce rythme est étalé dans le temps de façon équivalente. Voilà ce que l’humanité de chaque être rencontre dans les derniers instants de sa vie, à partir du moment où est faite l’annonce de la maladie létale.
Je vais illustrer ceci par l’expérience que j’ai faite dans l’accompagnement de Pierre.
Pierre arrive à l’hôpital pour une hospitalisation en service de Soins Palliatifs. C’est un père de 3 garçons. Sa femme d’origine réunionnaise l’accompagne. Elle est abattue avec un sentiment de culpabilité. Personne n’a osé évoquer le pourquoi de la venue de Pierre en soins palliatifs. Nous sommes en 1998. Les enfants ne savent pas que leur père est en fin de vie. Sa femme se tait de peur de laisser paraître son inquiétude pour l’avenir. Pierre restera 9 jours dans ce service. Trois périodes régulières sont repérables. Les trois premiers jours, l’équipe accompagne un homme épuisé, mais ouvert. Madame est là et se tait, tant devant son mari qu’auprès de l’équipe soignante. Le quatrième jour s’engage une deuxième période de trois jours. Elle commence par l’appel au secours de Madame. Comment parler à son mari, vivre ces derniers instants avec intensité pour elle et ses enfants ? L’équipe entend son impasse et vit avec elle cette interrogation. Repris en groupe de parole, l’énoncé de l’impossibilité de l’équipe à résoudre cette question se transforme en constat et partage. Le soir même, un membre de l’équipe a l’occasion d’évoquer, en présence de Pierre et de sa femme, notre attention partagée à la situation souffrante. La fin de vie est alors parlée. Soulagement de Pierre et de sa femme. Les enfants viendront le lendemain, Madame retrouve le sourire et la parole. Les trois derniers jours sont calmes malgré la présence d’une famille paternelle, rejetante et humiliante, si ce n’est raciste envers la femme de Pierre. L’équipe de soins va renforcer sa présence auprès de Madame pour l’aider à vivre ces instants avec ses enfants.
La famille de Pierre n’était pas prête à cette fin de vie. Il faudra deux moments de crise, encadrés par trois périodes régulières pour que quelque chose de la vérité se dise et que l’équipe protège Madame du conflit avec la famille de son mari. Sur un rythme propre à chaque individu et équilibré en temps, se déploie, le refus, le subi et l’acceptation de ce qui se dénoue avec la mort.
Je souhaiterai maintenant vous décrire ce moment si singulier du 3e temps : celui l’acceptation de la fin de vie. Ce temps commence par un moment de réconciliation. Le drame de la fin de vie est aussi une chance. Il redonne à l’être humain la possibilité de retrouver des filles, des fils, des parents, des amis, tous ceux qui ont fait son humanité. Ces personnes qui avaient pris de la distance, qui s’étaient fâchés, ou avaient volontairement disparus, les personnes en fin de vie les attendent. Elles attendent un contact, un appel, un regard, un signe, un « je t’aime », qui a été trop longtemps suspendu. Pour en témoigner, voici une seconde expérience.
C’est au cours d’une consultation, à domicile que nous rencontrons Jacques, 38 ans. Il termine sa vie à la suite d’un cancer des poumons largement diffusé. Nous avons rencontré Jacques et sa compagne six fois en deux mois, nous l’aurons accompagné jusqu’au terme de son existence.
A la première entrevue, Jacques est douloureux, à bout de souffle. Sa compagne est présente. Couché sur un brancard, son visage reflète l’angoisse devant ce qui lui arrive, l’incompréhension des suites de sa maladie déclarée depuis 9 ans et une farouche revendication à vivre. Après une longue consultation qui donne une réponse médicale à la douleur j’invite Jacques à réfléchir sur son insistance à vouloir reprendre le travail.
Il veut retravailler. Cette détermination, il l’affirmera avec force pendant deux entretiens. Il mettra désespérément à l’épreuve sa décision. L’agressivité qu’il s’inflige se traduira par des reproches à sa compagne, avec qui il n’est pas marié. Il l’étonne en accusant celle-ci d’être capable d’abandonner leur petit garçon de 3 ans. Cette souffrance, presque criée, laisse entrevoir autre chose de son histoire. Jacques est à bout de souffle. Il appelle. Il espère autre chose. Nous l’invitons simplement à revenir nous voir dans une semaine.
A la deuxième consultation, Jacques est moins douloureux, plus tonique. Il fait quelques pas puis s’assoit. Je l’invite à parler de lui. Son père s’est suicidé lorsqu’il avait 3 ans. Il est le dernier de 6 frères. Très vite il s’est isolé et a quitté sa famille dès 14 ans. Il ne voit plus sa mère. Tout en évoquant son histoire, il comprend qu’il y a un parallèle entre la situation qu’il a vécue : mort de son père quand il a 3 ans, position de sa mère, et la situation actuelle avec sa compagne et son fils de 3 ans. Peu à peu des questions émergent : que s’est-il passé quand son père meurt à 40 ans, il a lui-même 38 ans et son fils, 3 ans ? Le silence qui a suivi la mort de son père est-il une condamnation du petit homme qui psychiquement élabore à cet âge son intérêt sexuel en privilégiant la mère et rejetant le père ? Sa pensée est-elle magique ? Est-il responsable de la mort de son père ? Jacques est confronté à ces questions qu’il n’arrive pas à élaborer et qui font remonter un sentiment de culpabilité qu’il projette sur sa femme : elle pourrait abandonner son propre fils. Comment aider ce fils de 3 ans à vivre la perte de son propre père ? Est-ce que l’histoire se répète ? Ces questions sont en filigrane, soutenues par une reformulation claire de ma part.
Troisième consultation, Jacques revient avec sa compagne dix jours plus tard. Il est peu douloureux, mais somnolent. Le traitement est rectifié. Jacques comprend avec beaucoup d’émotion que c’est la fin de sa vie. Il accepte ma parole, « l’échéance est proche… ». La mort n’est plus dangereuse. Il ne s’agit pas d’une condamnation à mort. En tout cas, ni sa compagne, ni nous, nous « ne le condamnons à mort » pour le suicide de son père. D’autres le pensent, ajoute-t-il : « il faut se tuer à la tâche, comme son père qui a été un grand travailleur » ; ce père qui était dévalorisé par la mère.
De cette parole libératrice, Jacques va engager une démarche initiatique incroyable pour dépasser cette question de la culpabilité en l’amenant à sa résolution finale : assumer le père en lui. Nous l’assurerons de notre présence sur ce chemin de vie.
Jusqu’à présent, Jacques s’est dépris de son histoire, des liens avec sa famille d’origine et présente. Mais peut-il tenir cette place au moment de partir. Le temps de la vérité sur sa fin de vie va venir s’inscrire comme fondateur d’un passage à autre chose, pour un lien révélé.
Ce lien se développe en 3 notions : le lien personnel, le lien social et le lien sacré ou inconscient.
Premier lien : La naissance est biologique et le lien personnel en est le substrat
« Chacun a une place », tel est le décret de la filiation
Un mois après le début des entretiens, nous rencontrons Jacques pour la quatrième fois. Des douleurs continuent, le traitement est adapté. Puis il nous parle longuement de cette mort inopportune qu’il accepte. Il vient d’en parler au téléphone à sa mère et à son frère aîné qui habitent à 100 km. La déception, en raison de leur réaction indifférente, lui rappelle le silence qui s’est établi après la mort de son père. À l’époque, « on » lui a interdit d’aller au cimetière, ce qu’il a respecté. Parti loin de son village familial, il maintiendra des relations peu fréquentes. Mais à ce jour, sa décision est prise, il ira « rencontrer son père au cimetière ». Sa conviction, soutenue par sa compagne, balaie toutes les difficultés. Faire 100 km, dans une 2CV menée à 20 à l’heure pour éviter les secousses, affronter l’émotion d’une rencontre avec l’esprit de son père, ne pas rencontrer sa famille, (sa mère habite au village proche du cimetière), c’est la tâche ardue que Jacques, avec sa compagne et son fils, va porter à sa réalisation quelques jours plus tard. Cet effort physique et cet épuisement psychique de Jacques sont peut être la rançon pour renouer avec la filiation et offrir à son fils une place : il a un grand-père admiré par son père. Voilà pour le lien personnel.
Deuxième lien : la naissance est sociale et le lien social en est le substrat
« chacun a sa place », tel est le décret de la généalogie
Après avoir repositionné son fils dans la filiation, Jacques et sa compagne ont souhaité l’inscrire dans la généalogie : ils décident de se marier. Quelle conséquence cela engage-t-il ?
Cinquième consultation.
Quinze jours plus tard, nous retrouvons Jacques et sa compagne. Il est dépressif, douloureux, épuisé, alité. La visite au cimetière et l’émotion associée le rend heureux mais à bout de souffle. Son frère aîné l’a appelé. Peut-être un lien familial va-t-il se renouer ? Vont-ils venir à son mariage ? Ce projet est prêt. Il va se réaliser dans une semaine. Le maire se déplacerait à domicile. Jacques sera-t-il encore présent ? … Nous le rencontrons trois semaines après ce cinquième entretien. Il est sans force, mais sans douleur, heureux et… barbu. Le mariage a eu lieu en présence de quelques amis et de son fils. Sa mère n’est pas venue. Un frère et une sœur les ont félicités. Quelle extraordinaire démarche pour cet homme et cette femme qui vivaient une certaine marginalité sociale ! Ils offrent à leur fils une reconnaissance généalogique. Ils le situent définitivement dans la lignée humaine, ils l’introduisent à l’éthique, au lien social. Tout ceci s’est fait à dix jours du décès de Jacques.
Troisième lien : la naissance est inconsciente et le sacré en est le substrat
« chacun est tiers », tel est le décret de l’Autre
Quel extraordinaire accompagnement parcouru avec Jacques et sa femme en six entretiens sur deux mois ! Mais tout n’est pas clos, Jacques va nous faire franchir une dernière étape.
Nous apprendrons qu’il est décédé dix jours après son mariage.
Un mois plus tard, je rencontrerai sa femme et pour la première fois son fils, Sébastien. Elle vient nous voir pour clôturer cet accompagnement, nous remercier et raconter les derniers instants de Jacques
En voilà l’essentiel. Les soins à domicile étaient devenus trop lourds pour elle. Quatre jours après le dernier entretien, Jacques est entré dans un hôpital plus proche de son domicile. Il y décède une semaine plus tard. Juste avant de mourir, au matin, Jacques demande qu’on le rase pour « être comme avant ». Sa femme a passé la nuit près de lui, il la renvoie pour qu’elle aille s’occuper de leur fils. Elle part au moment où deux aides soignantes entrent pour la toilette et le rasage. Il décède pendant ce moment de dévoilement. Sa femme l’apprend avec calme, comprenant que son mari a souhaité qu’elle soit présente près de leur fils, à ce moment.
Jacques est parti après avoir accompli dignement, humainement, la transmission auprès de son fils. Il l’a resitué dans la filiation et dans la généalogie de sa famille, il venait de confirmer la responsabilité de sa femme pour la tâche qu’elle avait à mener : transmettre la vie sans refuser pour elle un temps de deuil personnel. Il transmet ce qui est de la responsabilité de tout parent : faire grandir son fils dans le respect des règles et l’attention à l’autre.
La douleur calmée, la souffrance prise en compte, la présence solidaire et interdisciplinaire des différents acteurs (soignants à domicile et hospitaliers, famille, amis de voisinage) ont reconnu à cet homme son humanité et ont témoigné qu’il y a toujours quelque chose à faire jusqu’à la mort. Lorsqu’il éclaire son visage par le dévoilement final, Jacques nous laisse ce regard, sans doute son esprit, comme vivant. Les deux aides-soignantes en témoigneront avec émerveillement : « le plus beau cadeau, c’est cet accompagnement que nous avons pu vivre ! ».
Cet émerveillement nous place au plus près du sacré, le troisième lien, après celui du lien personnel et du lien social.
Lorsque ce temps de réconciliation n’est pas possible, il appartient à la société d’offrir ce moment aux personnes en fin de vie. C’est le rôle des bénévoles comme des soignants. A ce titre, ils sont invités à être des « pères ». Rappelons-nous la distinction : être mère, c’est prendre soin. Chaque soignant est mère quand il soigne ; chaque bénévole est mère quand il est présent pour dialoguer, lire le journal, veiller pendant le sommeil. Mais quand il n’y a plus rien à faire, que la douleur est plus ou moins calmée, et qu’il reste ce solde pour tout compte qu’est la souffrance, ce ressenti, cette angoisse qui est la trace spécifique de tout être humain, alors il reste une place impuissante, mais présente : la place du père. Etre là, solidaire de l’angoisse manifeste, sans réponse.
C’est parce que cette place de père est offerte à la société et à tout accompagnant, famille, bénévole, soignant, que la fin de vie reste un mystère qui ouvre à autre chose que le mourir qui s’annonce, à un à-venir que certains appellent adieu. Le dieu ou le divin qui est d’abord en soi et soi-même.
Lorsque le moment arrive où la personne va lâcher prise, va passer de ce monde en un autre, une tri-unité va se manifester dans tout son éclat. L’imminence de la mort, l’attente de sa présence, l’ambiguïté inéluctable du résultat vont être vécues avec toute l’intensité tragique d’un mystère qui nous échappe. De grandes civilisations nous ont laissé le témoignage écrit de ce passage trinitaire, ainsi le “Livre des Morts” égyptien[1], le Bardo Thödol tibétain et d’autres. Fruit d’une longue observation, le livre des morts, déclamé rituellement par un accompagnant auprès du mourant, décrit trois étapes principales au moment de l’agonie et de l’après mort : rite de l’appel à ne pas revenir en arrière, rite de la séparation du corps et de l’esprit, et rite de la manifestation de l’esprit comme vivant éternel.
Pour notre monde occidental, le moment de l’agonie pourrait être compris comme l’ultime passage où trois lignes de fait peuvent se déployer. Ceci peut se faire en présence d’un tiers, qu’il soit familial ou accompagnant. En acceptant cette place, ce « tiers » est aspiré à découvrir, au moment de l’agonie de la personne, trois lignes de fait : une purification, une communion, un témoignage.
Première ligne de fait.
L’agonie n’est pas désespérance, elle est le combat de l’espérance, une purification, car chacun a une place. La personne en fin de vie est dans une solitude absolue. Elle est seule à vivre cet instant d’agonie. Les accompagnants sont solidaires mais seulement témoins de ce qui se passe. Cette personne va vivre une mort à soi-même comme tant d’autres morts à soi-même dans le quotidien de la vie qui sont des purifications passives. Tout au long de la vie, nous avons tous vécus ces moments particuliers d’échec, de désespérance, de mal-être. Chaque événement douloureux conduit la personne à reconsidérer sa vie, son style de conduite et à se laisser ouvrir à autre chose. La personne en fin de vie est invitée à une dernière mort à soi-même comme une purification active pour renaître. C’est la rencontre avec un humain présent, qu’il soit soignant, bénévole, ou familial, qui préfigure, transfigure l’ami fidèle, le Consolateur, que certains appellent le grand Autre. Cet instant n’est-il pas naissance comme celle où nous avons été césuré réellement de notre placenta et non de notre mère ? Pendant neuf mois ce placenta a été comme notre double indispensable, consolateur, ami fidèle, protecteur. Une dernière fois, la personne va être éprouvée et purifiée. L’agonie est purification, première ligne de fait.
Deuxième ligne de fait.
L’agonie n’est pas solitude, elle est communion avec tous ceux qui sont passés par là, avec tous les suivants, car chacun a sa place. La communauté humaine, par sa présence, signifie cette solidarité. Elle rappelle que cette épreuve de la mort est à l’image de toutes les épreuves. Chaque humain présent, prenant la place du “père”, à un moment ou à un autre de l’accompagnement d’une personne en fin de vie, soutient la marche en avant de celle-ci. C’est ce que je peux appeler la responsabilité du père. Etre là, solidaire quand il n’y a plus rien à faire. La fonction paternante en chacun de nous peut se déployer si nous acceptons de la faire vivre. Toutes ces épreuves nous rendent plus “sain(t)”. L’agonie est communion, deuxième ligne de fait.
Troisième ligne de fait.
L’agonie est témoignage d’autre chose. Antichambre du lâcher-prise, c’est souvent le dernier sursaut du refus de la mort. La perlaboration, aidée par l’équipe soignante, le bénévole ou la famille, prépare la personne à lâcher-prise, à vivre son chemin impossible, à accepter l’échéance. L’impuissance, l’impasse de l’action, l’inéluctable, voilà des témoignages vécus par l’interrelation entre les acteurs et la personne en fin de vie. Ainsi cette personne, peut témoigner d’un « aller vers » la mort en exprimant pour elle, et autour d’elle, la certitude d’autre chose qui s’apparente pour certains à la certitude de la victoire de l’Etre sur la mort. Tous les vivants sont engagés à vivre la séparation et à en témoigner, qu’ils soient accompagnés ou seuls au moment de leur mort. Car chacun est sacré, au sens de sacrifice.
Je voudrais, pour suspendre ce temps de parole qui appelle au dialogue, partager avec vous ce cadeau fait par Aurélie, il y a quelques années. Je l’ai rencontrée à la suite d’une conférence où j’avais évoqué les anges ou les personnes invisibles bienveillantes qui nous accompagnent. Elle a souhaité me confier ce moment si fort où lors d’une greffe cœur-poumon qu’elle venait de vivre ; pendant l’anesthésie, elle avait eu la vision d’un enfant lui prenant la main. Ceci était difficilement entendable par bien des personnes. Nous avions longuement évoqué cet ange gardien qui l’accompagnait. Malgré la distance et une nouvelle greffe rejetée un an après, nous restions en contact et je l’accompagnais vers sa fin de vie. Elle avait 31 ans. Peu de temps avant de mourir, elle a écrit ce texte et cette musique. Elle a souhaité que je le reçoive après son décès. Je vous offre cette rencontre que chacun peut s’approprier, s’il le souhaite.
[1] . Guy Rachet, Le Livre des Morts des anciens égyptiens, Ed du Rocher, 1996.